tête-de-moine n. f. (parfois tête de moine)

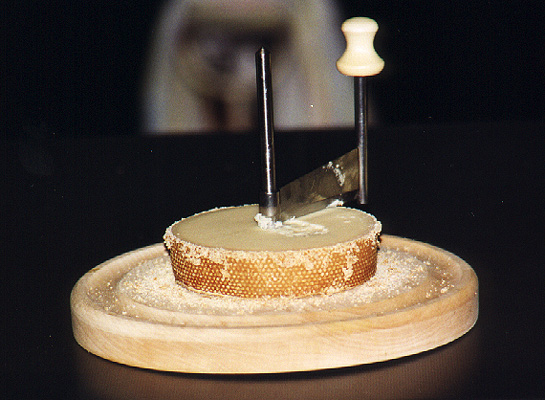

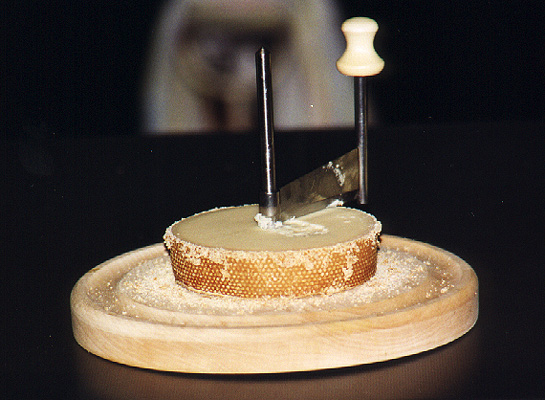
◆ Fromage de lait de vache à pâte mi-dure, de forme cylindrique, que l’on racle en fines
tranches frisées qui s’enroulent sur elles-mêmes.
★ Jadis élaborée artisanalement dans quelques villages jurassiens, la tête-de-moine
est aujourd’hui fabriquée industriellement dans les districts de Moutier (BE), Courtelary
(BE) et Franches-Montagnes (JU), à base de lait cru provenant de vaches qui ne sont
pas nourries avec de l’ensilage. La tête-de-moine est un fromage de dessert. Produire des têtes-de-moine. ⇒ jura.
1 « Que le béotien qui se trouve pour la première fois en face d’une tête-de-moine n’aille pas commettre le sacrilège de l’entamer d’un coup de couteau vertical ! Ce
fromage doit se décalotter en enlevant la croûte supérieure sur une épaisseur d’un
bon demi-centimètre. La pâte doit ensuite se racler avec une lame large tenue en légère
oblique et en tournant régulièrement autour du fromage pour maintenir la surface bien
plane et permettre sa consommation totale. » J. Montandon, Le Jura à table, 1975, p. 82.
2 « Implantée à Saignelégier [JU], une nouvelle fromagerie a vu le jour, dédiée à la production
de la tête de moine. Curiosité typique jurassienne, cette dernière devrait regagner quelques lettres de
noblesse et autant de parts du marché alimentaire helvétique. Car avec l’inauguration
de la bâtisse, un concept de marketing conséquent a été imaginé pour redynamiser le
produit autrefois monacal. Les objectifs sont clairs : chaque Suisse devra digérer
une demi-tête de moine l’an. […] Avec une production annuelle de 1000 tonnes, les fabricants de tête de moine, réunis en association depuis 1978, espèrent à terme pouvoir écouler en Suisse pas
moins de 2000 tonnes de ce délice à pâte mi-dure. » L’Express, 19 octobre 1995, p. 15.
3 « La tête de moine, le jura* salé et la tomme* neuchâteloise au poivre étaient d’excellente qualité. » Courrier neuchâtelois, 13 mars 1996, p. 24.
4 « Je suis heureux qu’en Suisse un producteur se soit remis à faire du vacherin* au lait cru. Mais pour ce qui est de la tête-de-moine, il n’y a qu’un petit agriculteur, biologique, qui en fait d’une manière artisanale,
traditionnelle, alors que le reste n’a plus grand-chose à voir avec cette longue tradition.
[…] Je me souviens de la consistance crémeuse de ces têtes-de-moine, dont certaines avaient pour défaut de se fendre sur les bords. Elles étaient pansues,
alors qu’aujourd’hui elles sont droites comme si on avait tiré un fil à plomb pour
les fabriquer. » Femina, interview du restaurateur jurassien G. Wenger, 8 juin 1997, p. 54.
↪ V. encore s.v. jura.
Remarques. Il existe depuis quelques années sur le marché (© 1987, Lagirolle SA, Lajoux FR) un
instrument spécial servant à racler la tête-de-moine, appelé girolle n. f. ; il s’agit d’un nom de marque déposé (« La girolle (pour la tête de moine) est menacée par les copies d’une maison danoise. » Courrier neuchâtelois, 22 novembre 1995, p. 3). Cet instrument est composé d’une base circulaire en bois
munie d’une tige centrale en métal, sur laquelle on embroche la tête-de-moine ; une
lame munie d’une poignée rotative et fixée à la tige centrale permet de racler le
fromage par un mouvement circulaire et régulier.
Commentaire. Première attestation : 1855 (tête de moine, v. Pier). Dénomination métaphorique, par analogie avec la tonsure des moines. La
même lexie a aussi désigné, en France, une espèce de gros fromage d’Auvergne (de 1493
à Lar 1876, v. FEW), et, dans le Doubs, un fromage de Gérardmer (Vosges) ; v. BeauquierDoubs
1881. — La tête-de-moine est exportée dans toute la Suisse et même à l’étranger sous
son appellation française ; on ne relève pas sur les étiquettes de terme allemand
ou italien pour la désigner.
Copyright © 2022, tous droits réservés